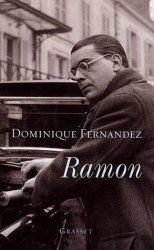(Paris, Grasset, 2008)
La lecture des livres de Dominique Fernandez (romans, livres de voyage, photographies) m’a toujours procuré un très grand plaisir. Avec, cependant, deux petits bémols. Pour se rassurer, j’imagine, Fernandez éprouve le besoin d’en faire des kilos, d’écrire jusqu’à plus soif. Dans son très beau livre sur Tchaikovski, par exemple, s’il ne nous décrit pas trois cents rues et artères russes, il n’en décrit aucune. Dans son Ramon, il nous inflige, par le menu (c’est le cas de le dire), la liste des vingt-sept convives invités par ses parents lors des quarante-trois repas littéraires donnés en leur appartement. Il y a également chez Fernandez, dans nombre de ses ouvrages, un fond de bidet rance. Il ne peut s’empêcher de renifler les remugles, de regarder par les trous de serrure. Dans ce dernier ouvrage, il évoque la rumeur de seconde main selon laquelle Drieu la Rochelle aurait couché avec Aragon. Si c’est avéré, cela n’a strictement aucun intérêt d’un point de vue littéraire et politique.
Ceci posé, Ramon est un livre important, tant dans le parcours personnel de l’auteur (« chacun ne commence à se retourner vers son passé », écrit-il, « que lorsque son avenir se rétrécit ») que pour l’histoire contemporaine de notre pays. Il fallait beaucoup de courage pour tenter de comprendre - sans jamais vraiment y parvenir, malgré 800 pages d’une quête douloureuse - comment un homme a évolué de la gauche à trente ans à l’extrême droite et à la collaboration à quarante-six ans, comment il a raté sa vie d’époux, de père, comment il a sombré dans l’alcoolisme, comment il est passé de l’estime de Proust, de Gide, de Mauriac, de Gallimard au service de Doriot et des nazis. A-t-il cru, comme le pensait Marguerite Duras, pouvoir trouver une solution politique à un problème personnel, se « guérir d’un mal privé » en versant dans la « débilité » idéologique ?
D’avoir un tel père conditionnera gravement l’oeuvre du fils qui inclinera vers les « héros fourvoyés, partagés entre la célébrité professionnelle et la flétrissure sociale », entre la gloire (en fait, bien souvent, la gloriole) et l’infamie.
Dominique va donc instruire à charge et à décharge le procès de Ramon, ce père admiré qui n’a quasiment jamais baissé les yeux sur lui. Le grand critique littéraire répondra à l’invitation de Goebbels, mais, contrairement à Brasillach, Céline et quelques autres, n’appellera jamais à la haine raciale, à la dénonciation des Juifs, pas plus qu’il ne s’adonnera à la propagande des nazis et de leur système. Ce très fin esthète (il livra la meilleure étude de l’époque consacrée à Molière) sera fasciné par la culture anglaise et se sentira étranger à la littérature allemande. Le romancier sera très tôt taraudé par des notions de soumission, de renoncement, de sacrifice, ces conduites qui nourrissent le terreau du fascisme.
Cet homme à femmes était-il un homosexuel refoulé qui aurait vu en Doriot, non un boeuf suant et éructant, mais un modèle d’homme du peuple viril, un chef charismatique et légitime pour les masses, un défenseur de la civilisation ? Ramon dénigra-t-il la mollesse de l’univers bourgeois au nom de la critique originale qu’il fit de l’univers proustien, dénué de hiérarchies de valeurs, incapable de progrès spirituel, un univers de « vaincus » ? L’envoûtement pour l’homme fort fut-il celui d’un individu qui détestait les faibles parce qu’il se savait faible ? Ramon a-t-il adhéré à un parti fasciste parce qu’il était revenu de l’individualisme ? Le Parti populaire français a-t-il agité en lui la part d’ombre de l’aventurier imaginaire, donc raté ? Autant de questions auxquelles Dominique apporte des réponses nuancées, hésitantes. Le fils écrivain est allé aussi loin qu’il pouvait sur le chemin de l’honnêteté, de l’exigence.
Il n’empêche : le 7 février 1936, Ramon signe avec des écrivains de la gauche non communiste dont il se sent proche (Guéhenno, Bloch, Alain, Malraux) un appel à la grève générale, à l’unité ouvrière pour barrer la route au fascisme. Il adhère à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires lancée par des écrivains communistes (Vaillant-Couturier, Barbusse) et au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes fondé par le physicien Paul Langevin (communiste), l’anthropologue Paul Rivet (socialiste) et le philosophe Alain (radical-socialiste). La fine fleur de l’intelligentsia française. Il pose que face à la « folie » du capitalisme, le marxisme est devenu « l’unique rempart des opprimés ». Il affirme qu’il ne tremblera pas au moment de rejoindre une « action prolétarienne ». Son analyse des intellectuels tentés par le fascisme est formidablement fondée : il voit dans ce mouvement totalitaire un piège tendu aux intellectuels bourgeois qui veulent bien d’une révolution à condition qu’elle ne touche pas à leurs habitudes, qu’elle ne lèse ni leurs intérêts ni leurs privilèges. Il apprécie la discipline de l’électorat de gauche après la victoire du Front populaire. Il va jusqu’à écrire que Marx est « le plus grand humaniste des temps modernes ». Alors, sa démission soudaine de l’AEAR restera pour Dominique un « mystère ». Le fils propose une piste : il y aurait chez son père « cette lancinante question, jamais résolue, de la patrie, des racines », avec cet engagement naturel dans un « parti dirigé par un ancien ouvrier qui s’était rebellé contre Moscou. » Fin 36, on trouve sa signature au bas d’un manifeste cosigné par des intellectuels ou créateurs de la pire droite : Claudel, Drieu, Bonnard, Daudet, Béraud, Massis. Contrairement à Mauriac et Bernanos pour qui la Guerre Civile espagnole est l’occasion d’un authentique risorgimento, Ramon soutient l’insurrection franquiste. Dominique pense que le Retour de l’URSS de Gide a agi sur son père comme un « détonateur », l’anticommunisme l’ayant aidé à surmonter son échec en tant qu’époux (son mariage fut un fiasco du début à la fin) et en tant qu’écrivain (il écrit de moins en moins).
Il rejoint le parti de Doriot en mai 37. Il estime - à juste titre, ce qui le rassure - que le discours de l’ancien maire de Saint-Denis a peu à voir avec celui de Hitler. Mais au même moment, Jules Romains intitule son tome XXIII des Hommes de bonne volonté : Naissance de la bande. Les activistes fascistes sont un gang. Dans la fiction, Doriot est dépeint comme un corrompu, un baroudeur sans états d’âme et qui deviendra dangereux dès qu’il se vendra au plus offrant. Les banques sont derrières le chef (y compris des banques juives). Qu’allait donc faire Ramon en cette galère, coiffé du béret fasciste, prêt à servir, à répondre aux rites et aux ordres les plus débiles ?
Il faut dire que les pratiques collégiales germanopratines de l’époque manquaient de netteté. Ramon écrit régulièrement dans Marianne, célèbre hebdomadaire radical dirigé par Emmanuel Berl, qui est juif et dont la plume s’est perdue dans les colonnes de L’Émancipation nationale, l’hebdo du PPF. Berl est cousin par alliance de Fernand de Brinon, collaborateur pronazi fusillé en 1947. Il rejoindra, un temps, Vichy, où il rédigera pour Pétain des discours passés à la postérité (« les mensonges qui vous ont fait tant de mal », « la terre ne ment pas »). Le PPF suscite des ralliements innombrables, et de poids : Benoist-Méchin, Lanoux, Carrel, Fabre-Luce (qui collaborera au Monde pendant trente ans, Haedens (futur résistant d’extrême droite qui défendra la mémoire de Maurras jusqu’à son dernier souffle).
Le financement du PPF par Ciano, gendre de Mussolini, la montée en puissance de Ramon parmi les cadres du parti feront se détourner Drieu, Journel, Fabre-Luce. En 1939, seule son activité de chroniqueur rattache encore quelque peu Ramon au monde de la littérature. Il prône une guerre sainte contre l’Allemagne. Mais en 1940, exonérant Hitler des actes commis par ses armées, il rend les capitalistes et les journalistes juifs responsables de la guerre. L’occupation d’une France décadente est, à ses yeux, correcte, déférente, même. Il entre sans vergogne dans la collaboration. Une victoire de l’Allemagne, estime-t-il, amènerait une « réorganisation politique, sociale et morale de la France ». Une victoire de l’Angleterre permettrait aux Juifs de « pulluler de plus belle ». La contiguïté germanopratine se poursuit pendant la guerre. Comoedia, hebdomadaire de bonne facture, accueille les signatures de partisans de la collaboration comme Brasillach, Aymé, de pacifistes pur sucre comme Giono, de " neutres " comme Cocteau ou Colette, d’éminences hostiles à la collaboration comme Paulhan.
A partir de 1942, Ramon cesse presque totalement de faire du journalisme politique. Il voit en Hitler un homme de gauche, propagateur réaliste d’une utopie socialiste. Il fait le voyage en Allemagne au moment où les murs de Paris se couvrent de listes de patriotes exécutés. Il rencontre Goebbels le jour même où Guy Môquet est passé par les armes. Que les plus grands écrivains de langue allemande (les frères Mann, Musil, Zweig, Broch, Werfel) soient contraints à l’exil ne semble pas le concerner. Il s’affiche auprès d’antisémites hystériques, comme Montandon, directeur de l’Institut d’étude des questions juives et ethno-raciales. Dominique peine à concevoir que, en l’occurrence, Ramon « ne pouvait pas croire à ce qu’il faisait ». Qui sait ? On peut fort bien avoir de l’aversion pour la peine de mort et laisser exécuter Ranucci, ne pas être personnellement antisémite et vouloir la disparition des Juifs. On peut défendre la mémoire de Bergson, la gloire de Proust, être scandalisé par le décret sur l’étoile jaune, monter solidairement dans le dernier wagon dans les métros et inventer des catégories complètement aberrantes, comme celles de la France des maîtres (en gros la République des professeurs, de gauche, laïques, formés par Anatole France et Jules Romains) et la France des mères, une France nationaliste, mystique, éternelle, dans le sillon de Péguy et dans la grâce Barrésienne.
Devient-on fasciste parce qu’on regarde trop son nombril, parce qu’on est imbu d’une différence (Fernandez était d’origine latino-américaine) que l’on intègre à la fois comme supériorité et infériorité ? Faut-il rater sa vie pour dériver politiquement. Ce fort ouvrage ne clôt pas le débat. Heureusement.